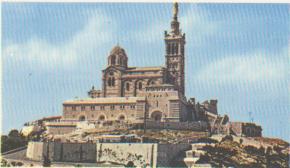Notre Dame de la Garde

H I S T O I R E
Procession à Notre Dame de la Garde vers 1770

Sans doute parce qu'elle est le point culminant de la ville (154 m), la colline de la Garde a toujours été un poste d'observation.
On dit traditionnellement, mais sans preuve, que la vigie existe depuis les temps préhistoriques et plus sûrement depuis l'époque romaine. Au XVe siècle une ordonnance de Charles II d'Anjou inscrit la colline de la Garde dans la liste des relais. On apprend que les signaux de jour se faisaient par des colonnes de fumée (en brûlant de la paille humide), et de nuit en allumant un feu clair.
Ce système de vigie va s'améliorer au fil des siècles et la fonction perdurera sur la colline jusqu'en 1978.

Pour protéger Marseille des armées de Charles Quint, conduites par le Connétable de Bourbon, François Ier fait construire un fort en 1524 au sommet de la colline, qui constitue avec le Château d'If à l'entrée du port, une défense maritime dont la ville était dépourvue. De nos jours, on peut encore constater la présence du fort servant d'assise à la basilique actuelle et retrouver au-dessus du porche nord la signature du Roi : une Salamandre.
Mais la colline de la Garde prend toute sa signification : signal sacré, signal urbain, dans la construction de la basilique en 1853. Désormais la silhouette de l'édifice devient indissociable de l'image de Marseille.
Cependant plusieurs églises ont précédé sa construction. La première en 1214, quand un ermite, maître Pierre, reçoit l'autorisation de construire sur ce terrain appartenant à l'Abbaye de Saint-Victor. A partir du XVIe siècle l'église se transforme peu à peu en un centre de dévotion des marins. De cette époque datent les premiers ex-votos qu'ils viennent y déposer.
Ainsi la colline de la Garde a-t-elle dès lors une triple vocation :
. un poste de vigie,
. un ouvrage militaire,
. un lieu de culte et de pèlerinage.
Au milieu du XIXe siècle, le sanctuaire s'avère trop petit pour les nombreux pèlerins qui le visitent. Monseigneur de Mazenod décide d'y construire une grande basilique. La première pierre est posée le 11 septembre 1853, les travaux
sont confiés à l'architecte Espérandieu et la consécration a lieu le 5 juin 1864.
VISITE
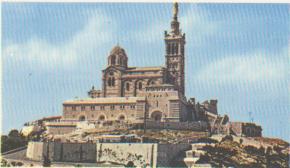
De style romano-byzantin : coupoles, polychromie des pierres, ors, mosaïques, la basilique répond parfaitement au programme des grandes constructions entreprises à Marseille sous Napoléon III.
L'édifice se compose de deux parties :
une église basse, crypte, voûtée qui abrite notamment un crucifix polychrome datant de l'église du XVIe siècle, une "mater dolorosa" marbre de Carpeaux ; une église haute, le sanctuaire, consacrée à la Vierge (fête et pèlerinage le 15 Août) où abondent les mosaïques à fond d'or et les marbres polychromes lui donnant l'aspect d'un reliquaire.
A signaler : les portes de bronze et le maître-autel dessinés par Revoil, co-architecte de la basilique, une Vierge en argent de Chanuel, une Annonciation bas-relief en faïence polychrome, oeuvre florentine du XVIe siècle.
La présence de nombreux ex-votos exposés sur les murs, suspendus entre les piles de la nef, constitue une véritable collection d'Art Naïf, chronique attachante de la société marseillaise, témoins éloquents de la foi populaire, dédiés à celle que les marseillais de toutes confessions désignent comme "la Bonne Mère".
Le campanile supporte une statue monumentale de la Vierge ; elle fut confiée au scuplteur Lequesne, exécutée en bronze doré à la feuille d'or par les ateliers Christofle et mise en place en septembre 1870.
Depuis l'esplanade, devant le sanctuaire, on découvre la vue la plus impressionnante de Marseille et de son site.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

La basilique et la crypte sont ouvertes en hiver de 7h30 à 17h30
et de 7h00 à 19h30 en été.
Accès au départ du Vieux Port : par le bus No 60, en "Petit Train de la Bonne Mère" (se renseigner auprès de l'officce du tourisme pour les horaires) et pour les plus courageux, à pied; ert passant par le Jardin de la Colonne en haut du cours Pierre Puget (prévoir environ 30 mn de marche).
POUR EN SAVOIR PLUS

Lire "Notre-Dame de la Garde"
de Françoise Hildesheimer (Editions Jeanne Laffitte)
Retourner au sommaire
![]()